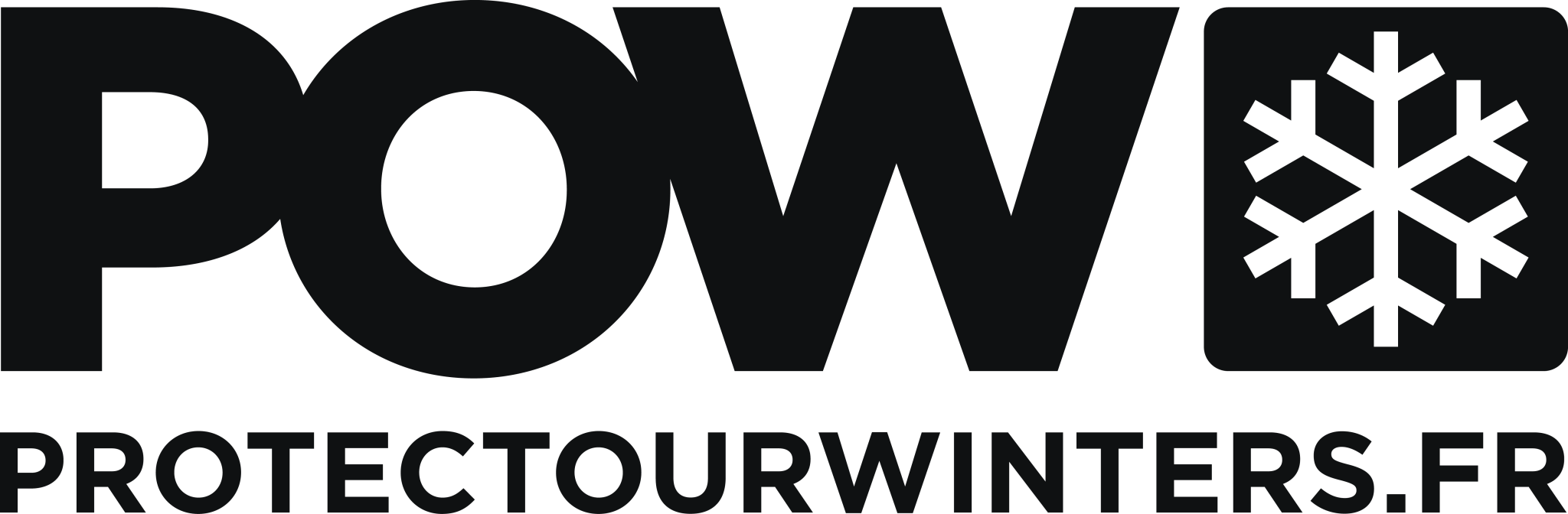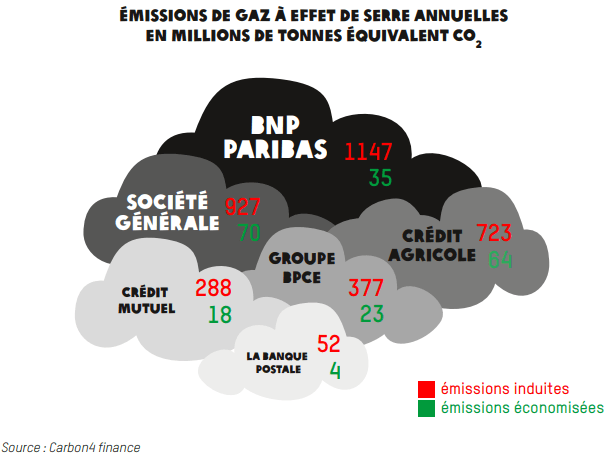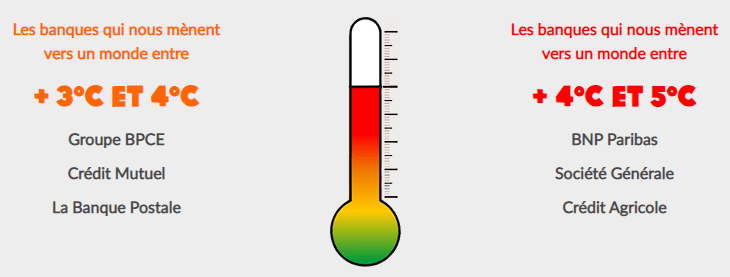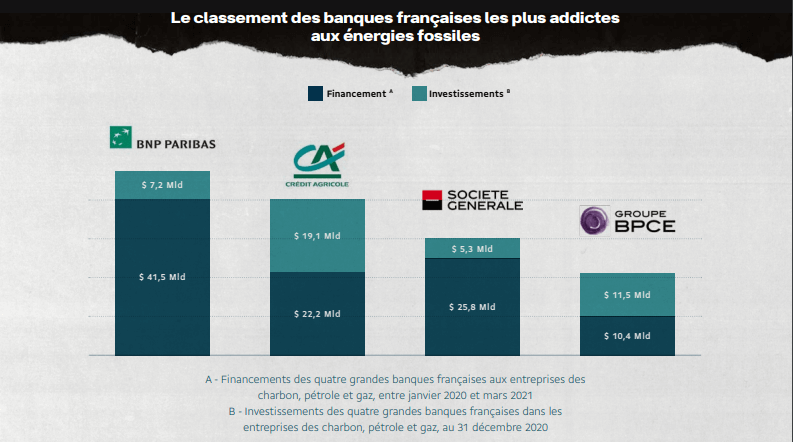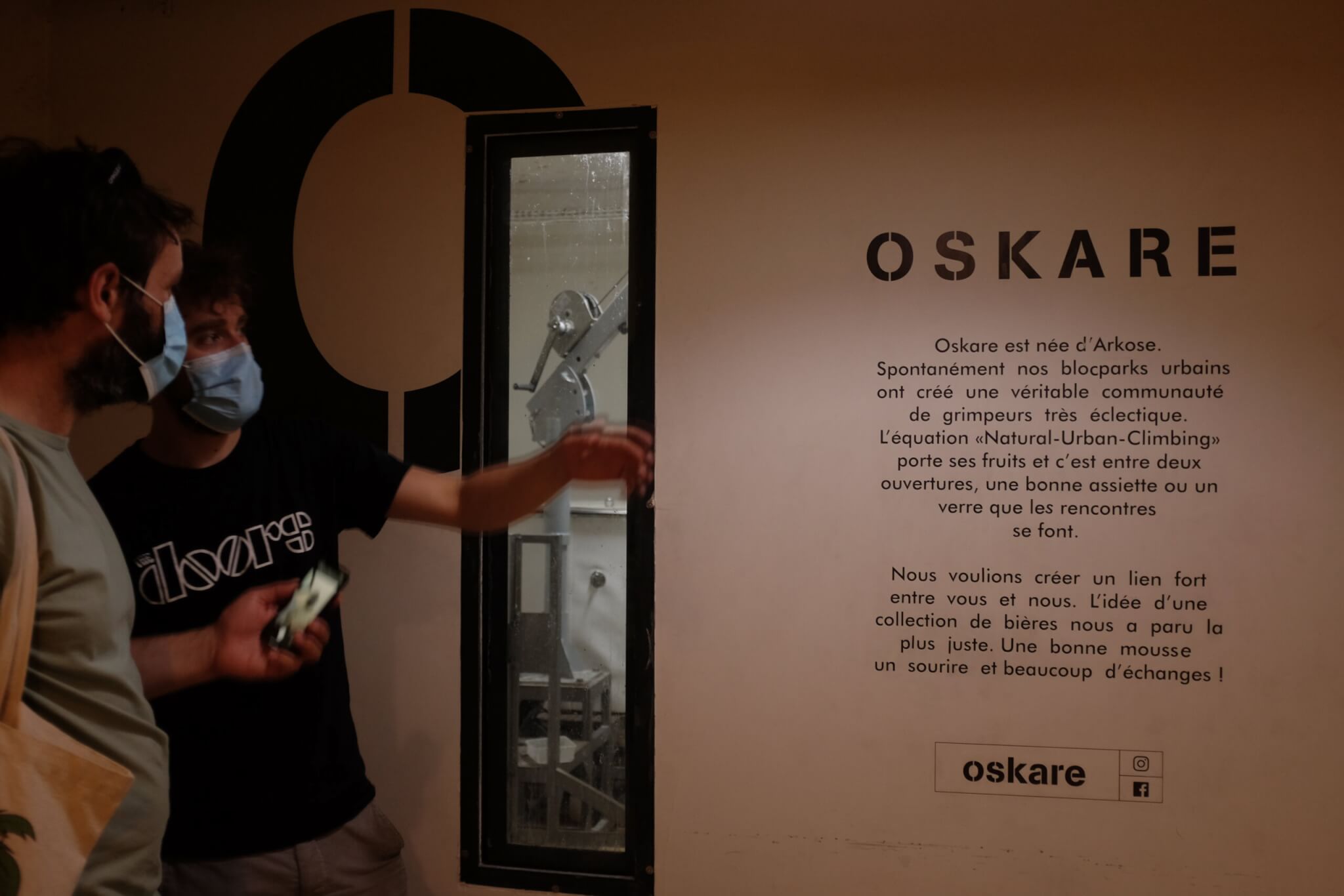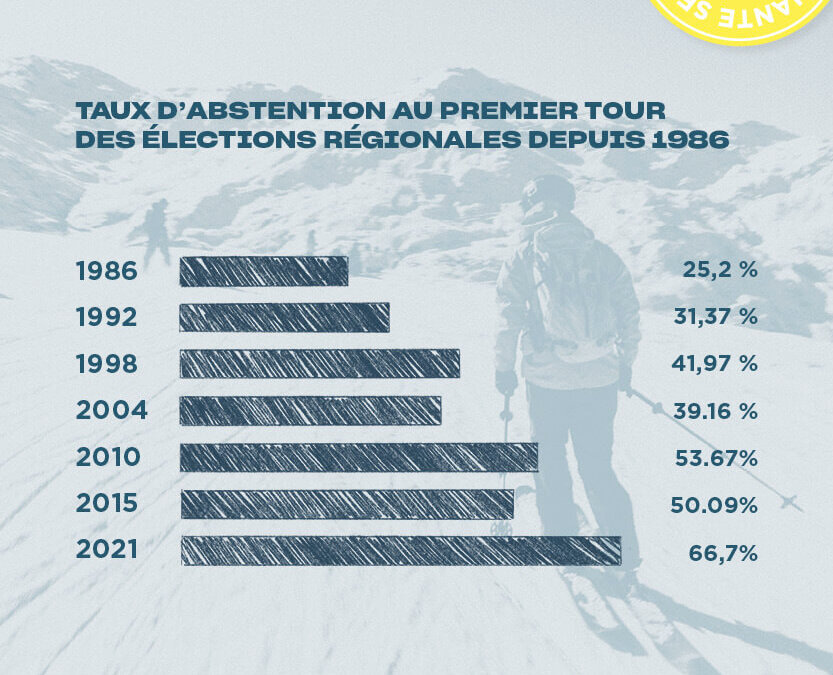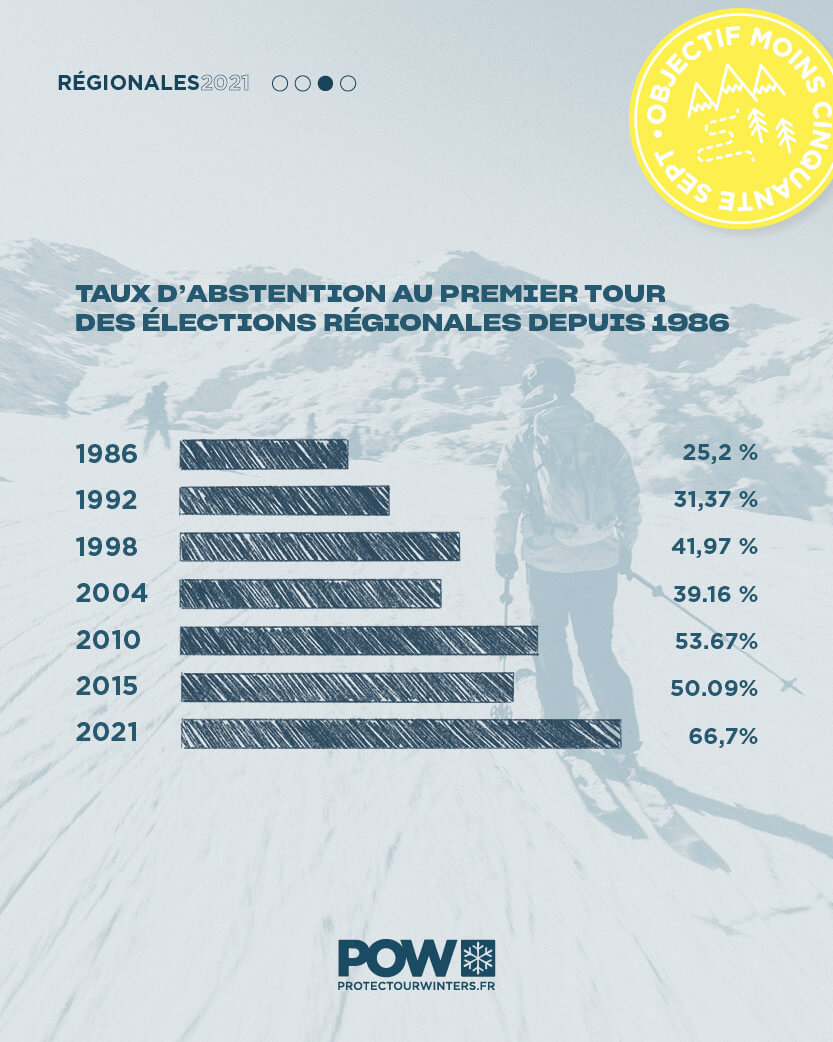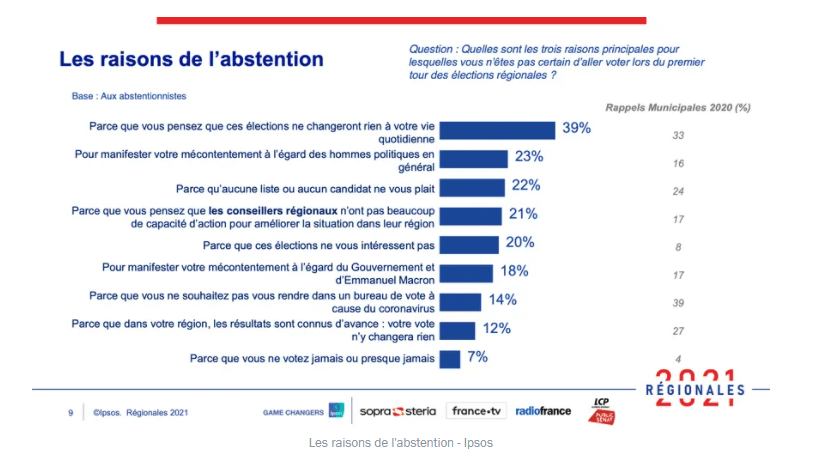Climat et médias C est ceux qui en parlent le moins
Climat et médias : C’est ceux qui en parlent le moins…
La sortie du film Don’t Look Up sur Netflix fin 2021 (allégorie non dissimulée de scientifiques qui essaient d’alerter sur le changement climatique sans être pris au sérieux par les gouvernements et la télévision) a remis la question du climat dans les médias sur la table. Tandis que l’arrivée des élections présidentielles ou encore la sortie du nouveau rapport du GIEC viennent confirmer ce problème : il faut se mobiliser !
Depuis plusieurs semaines, la question de la place occupée par le climat dans les médias ressurgit, au sein du monde associatif notamment. Pour cause ? Une place quasi inexistante dans les sujets traités, et ce malgré l’urgence et les enjeux auxquels nous faisons face. Le week-end dernier, nous étions plus de 80 000 à travers la France pour réclamer plus de climat et de justice sociale en vue des présidentielles.
Chez POW Fr, on s’inscrit totalement dans ce mouvement associatif engagé, et on vous propose un moyen d’action en vue des présidentielles et des législatives. On vous explique tout juste en-dessous ↓
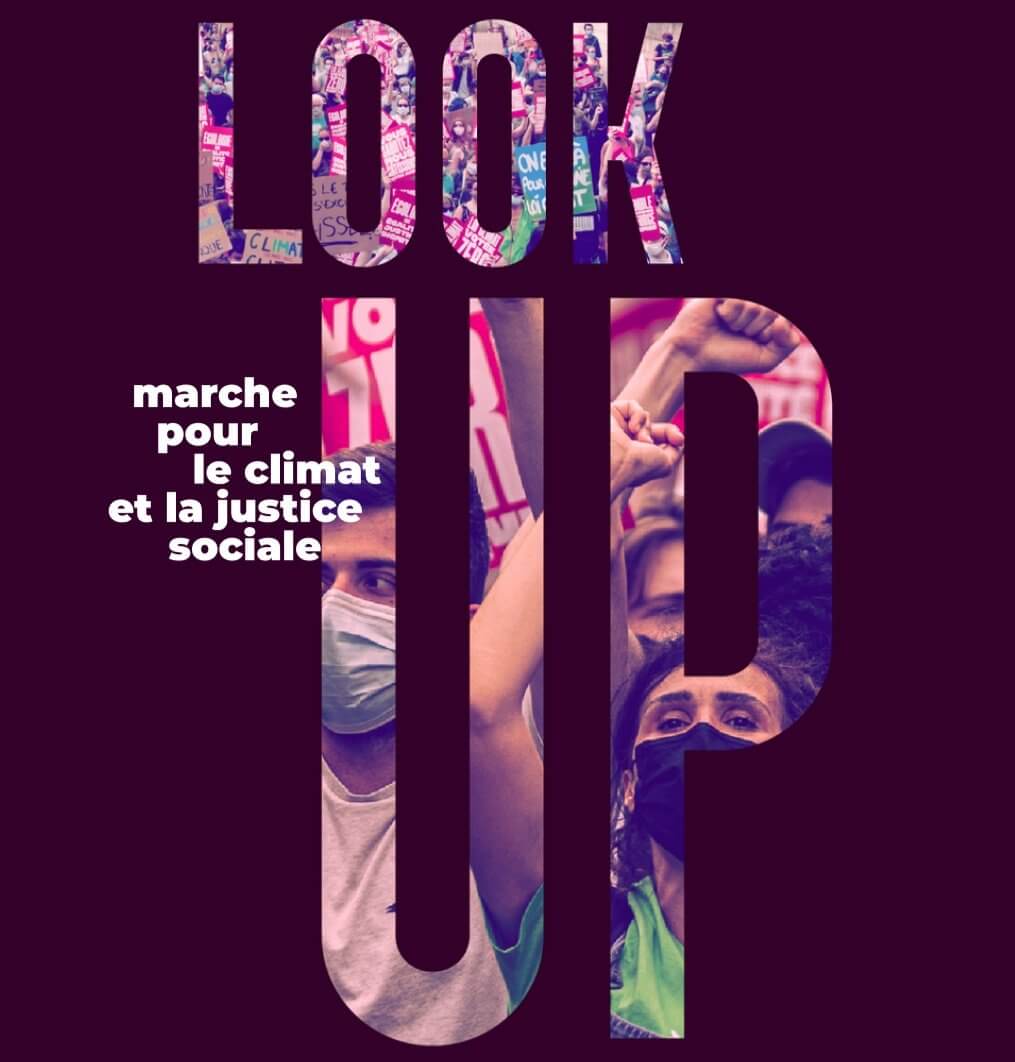

La première chose à comprendre : de quoi parle-t-on vraiment ?
Quand on pointe du doigt l’invisibilité du climat dans les médias, cela ne sort pas de nulle part et n’est pas un ressenti des associations ou des militant.es.
Une ONG de journalistes, Reporter d’Espoirs, s’est penché sur la question et a créé MédiasClimat, une étude autour de la grande question « Comment les médias traitent-ils du changement climatique ? » (présentée en juillet 2020 ici)
En bref, les premières conclusions montrent que le sujet représente en moyenne moins de 1% sur l’ensemble des médias en France.
Le comble ? Ces résultats sont le fruit d’une progression de la thématique environnementale au cours des 10 dernières années. On est donc passé d’invisible à transparent en 10 ans !
Notre ligne de conduite chez POW, ce n’est pas de pointer du doigt les imperfections de chacun, mais plutôt d’encourager à progresser.
Mais au vu des chiffres, de l’urgence de la situation, des alertes du GIEC… personne ne peut se réjouir des chiffres actuels.
Surtout que les préoccupations ne cessent de grandir chez les français.es concernant le climat, faisant du sujet l’une des préoccupations majeures. 1
L’étude nous explique également que les sujets environnementaux demeurent trop peu contextualisés dans le problème climatique. C’est à dire que même lorsque des sujets liés directement ou indirectement au changement climatique sont abordés, le lien n’est pas fait. Exemple avec le JT de 20H de TF1 : entre 2010 et 2019, 78 sujets ont trait à l’environnement, 4 d’entre eux seulement évoquent la question climatique et 1 seul de façon constructive. 2
Sur les 73 sujets ne faisant pas de lien avec le changement climatique, 50 % d’entre eux auraient pu l’être. (sécheresse et manque d’eau en France, feux hors de contrôle en Australie, inondation à Venise…)
« Bon, pas de climat dans les médias tout au long de l’année. Mais on en parle quand même lorsqu’il y a des sujets extrêmement importants non ? Non … ? »
Symptomatique de ce problème, le groupe 2 du GIEC vient de sortir son nouveau rapport, consacré aux impacts, à l’adaptation et à la vulnérabilité des sociétés humaines au changement climatique. Les adjectifs pouvant décrire les conclusions rapportées sont difficiles à trouver. Entre 3,3 et 3,6 milliards d’être humains vivent déjà dans des contextes très vulnérables au changement climatique 3
Ce rapport est un terrible avertissement sur les conséquences de l’inaction. Il montre que le changement climatique est une menace grave et croissante pour notre bien-être et la santé de cette planète. Nos actions aujourd’hui détermineront comment l’humanité et la nature s’adapteront aux risques climatiques croissants.
Pourtant, combien de temps ont consacré les chaînes tv au dernier rapport du GIEC ? Pas une minute pour TF1, M6, et 1 minute tout au plus pour France 2. 4 Certains diront que l’Ukraine prend une place majeure, et ils auront raison. Mais il est plus difficile d’expliquer que le carnaval de Venise ou le salon de l’agriculture prennent une place importante quand on ne dit rien ou presque sur l’un des rapports les plus importants de l’histoire de l’Humanité. Quand on connaît la vulnérabilité de ces deux sujets par rapport au climat (les inondations pour l’un, la vulnérabilité de l’agriculture au sens large vis-à-vis du climat pour l’autre) ou encore le lien entre la guerre en Ukraine et notre dépendance aux énergies fossiles, on regrette que la question écologique ne soit pas centrale dans la façon d’aborder les différentes actualités.

Maintenant qu’on a bien cerné le problème, que faire pour y répondre ?!
Même si l’étude nous montre qu’il n’y a que des mauvais élèves sur la question, on constate tout de même des inégalités en terme de traitement selon les canaux de diffusions utilisés ou les rédactions, mais également en termes de pertinence lorsque l’on aborde le sujet.
Une catégorie est sortie du lot et nous a particulièrement intéressé chez POW : la Presse Quotidienne Régionale.
Les PQR, c’est la première source d’information imprimée quotidienne en France, avec près de 3 900 000 exemplaires vendus par jour. En comparaison, les 8 titres français de la presse quotidienne nationale combinés diffusent chaque jour 1 200 000 exemplaires.
Ce sont les médias qui parlent de ce qui se passe dans nos départements et régions, qui peuvent avoir des analyses nationales comme municipales. Mais ce sont surtout ceux qui évoquent le moins le climat. Sud Ouest est la PQR qui en parle le plus avec un chiffre de … 0,87 % ! La moyenne étant à 0,68 % en 2019.
Un chiffre regrettable car traiter du climat à travers des sujets locaux est sans doute l’un des meilleurs moyens pour parler au plus grand nombre. Un chiffre d’autant plus regrettable qu’il est mis en face d’un autre chiffre : 28 %.
Selon les critères de MédiasClimat, 28 % des sujets traitant du climat dans les PQR sont constructifs. On le rappelle, est jugé constructif ce qui évoque à la fois le problème climatique et des réponses ou tentatives de réponses, permettant d’ouvrir une perspective de résolution. L’équation est donc simple : les PQR sont celles qui parlent le moins du climat, mais qui en parlent le mieux lorsque c’est le cas. Un paradoxe qui montre le potentiel et le rôle que pourraient devraient avoir les presses locales et qui nous a poussé à agir !
Ensemble, sollicitons la presse locale !
Chez POW, l’un de nos objectifs lors de nos campagnes de mobilisation, c’est de montrer que les barrières entre les citoyen.es et les différentes instances ne sont pas si infranchissables qu’elles n’en ont l’air. (comme par exemple l’action mise en place en août dernier qui permettait à chacun.e d’envoyer le rapport du groupe 1 du GIEC aux parlementaires et qui a provoqué des réponses directes d’élu.es)
Aujourd’hui, on vous propose de contacter 30 PQR ! En se basant sur les PQR les plus lues de France, et en faisant quelques ajustements pour essayer de couvrir l’ensemble du territoire, on vous propose un outil permettant d’envoyer un message à ces médias régionaux.
L’objectif, c’est d’être le plus grand nombre de personnes possible à faire part de la nécessité que les enjeux climatiques soient abordés plus souvent dans les médias locaux.
On a écrit le message mais vous pouvez le personnaliser si jamais vous souhaitez ajouter quelque chose (bien sûr, les insultes et discours de haine seront filtrés) vous pouvez aussi copier ce message et l’envoyer directement à l’un de vos médias locaux qui ne serait pas dans la liste. (liste ici)
Pour rentrer dans l’aspect plus technique : nous avons décidé de donner par défaut la possibilité à chacun d’envoyer aux 30 PQR, pas seulement la plus proche de chez nous ou encore celles proche de montagnes.
Le message n’est pas de vouloir plus de climat dans tel ou tel média, mais plus de climat dans LES médias. Et pour ça, on trouvait important de donner la possibilité à chacun.e de contacter des médias sur l’ensemble du territoire.
Avec la présidentielle qui arrive (spoiler : et les législatives qui suivront) et la présence bien trop faible du climat dans les débats, nous devons être nombreux.ses à interpeller sur le sujet.
Nous vous en avons parlé plus haut, notre campagne vient s’inscrire dans une mobilisation d’un grand nombre d’associations, ONG, médias indépendants etc. Nous pensons que notre travail permet d’ajouter quelque chose de supplémentaire, mais nous vous encourageons fortement à aller suivre le travail fait ailleurs. Nous avons regroupé différents contenus et moyens d’actions sur cette page (ici) pour creuser le sujet et participer à d’autres initiatives, découvrir les différents appels !
N’hésitez pas à nous partager des choses que vous avez pu voir passer sur le sujet, et à l’inverse, à partager notre outil aux personnes ou structures qui pourraient être intéressées.
C’est ensemble, en unissant nos forces, que nous arriverons à faire bouger les lignes !
En bonus, on vous laisse avec une infographie animée de l’évolution du climat depuis 1880 (Source ici)
https://presse.ademe.fr/2020/12/barometre-les-franc%CC%A7ais-et-le-changement-climatique-edition-2020-lenvironnement-reste-une-preoccupation-majeure-des-franc%CC%A7ais-malgre-la-crise.html .↩
Sont considérés par MédiasClimat constructifs des articles qui évoquent à la fois le problème climatique et des
réponses ou tentatives de réponses, permettant d’ouvrir une
perspective de résolution. .↩https://twitter.com/veronique_et/status/1498464603310891020?s=20&t=WTf-cSK7jM548DxQ-v6PCA .↩