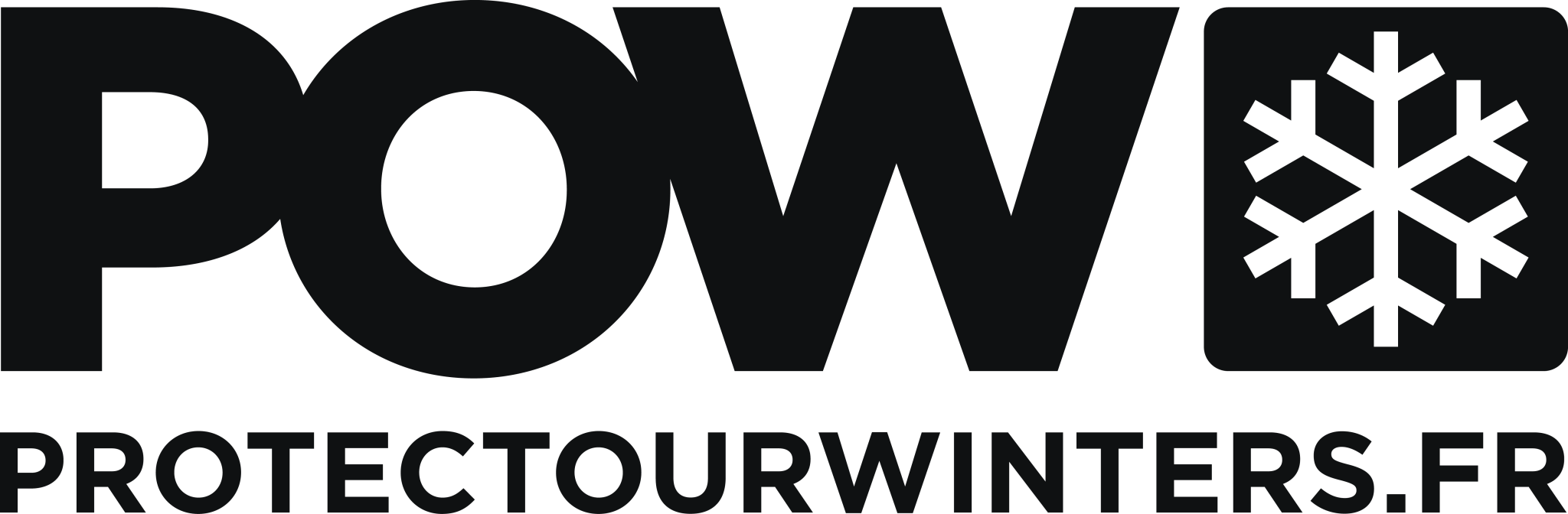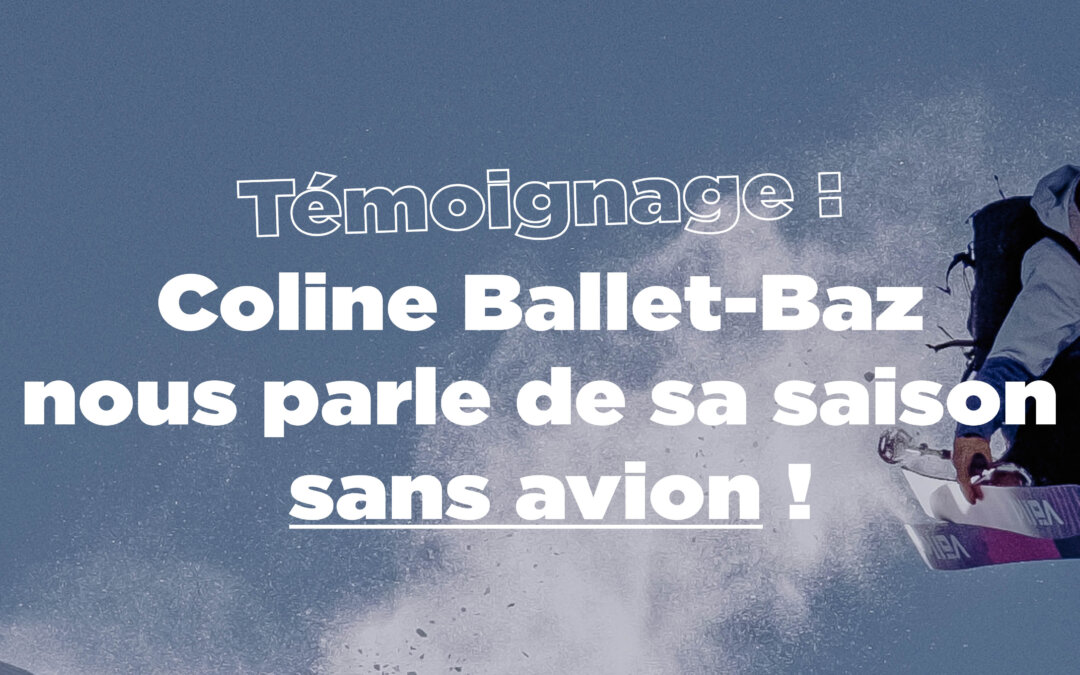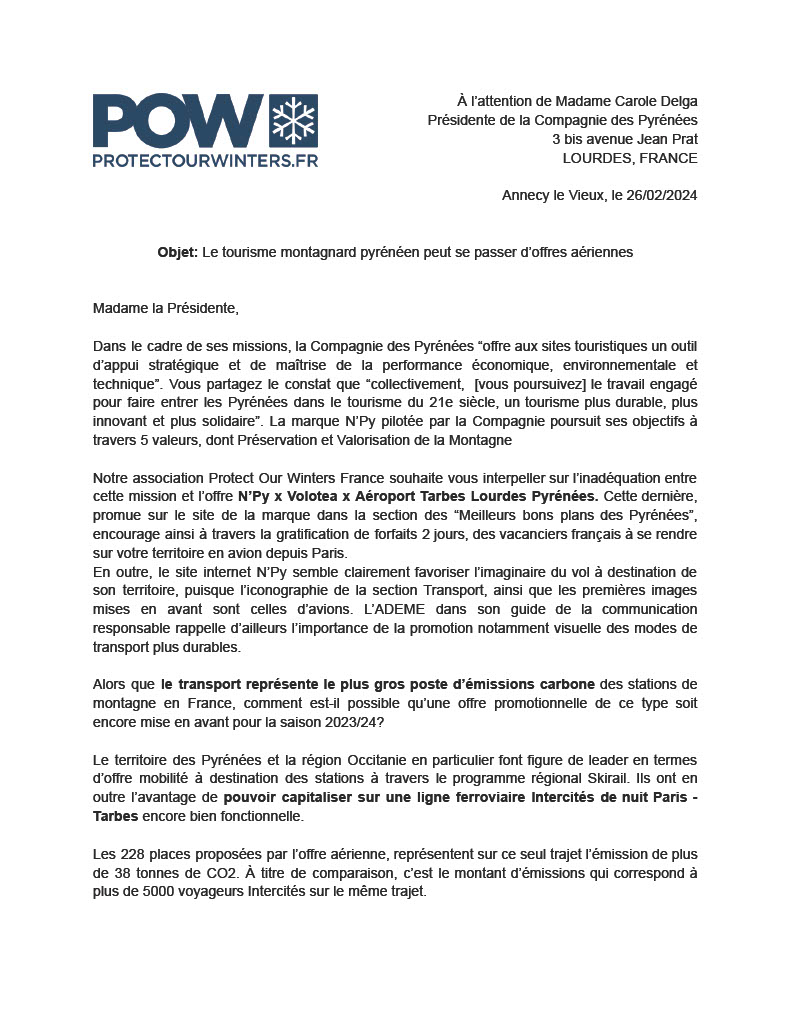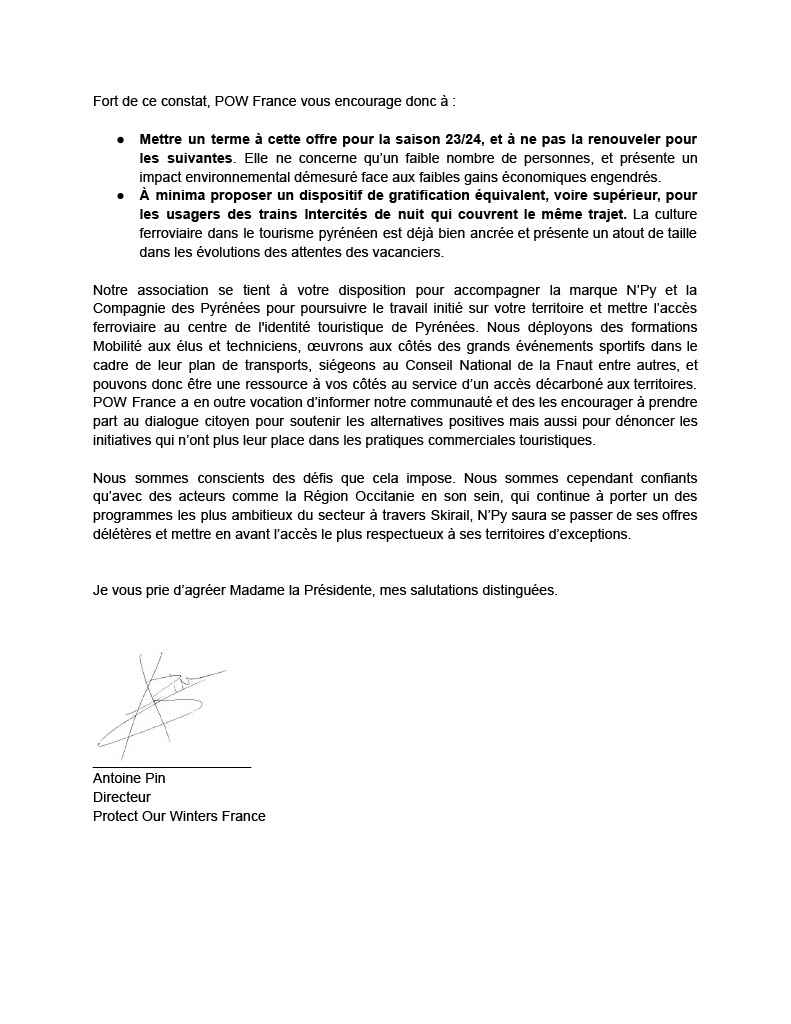Aventure à vélo : En Suède, tout roule pour Zoé !
Il y a ces moments dans la vie où rien ne va. J’exagère un peu, mais mon premier voyage à vélo est tombé à pic, un mois où rien n’allait. Mon périple a marqué le début d’un été où tout s’est mis à rouler – et c’était magique. Je vous raconte !
30 ans, ça se fête !
Quand, en janvier 2023, je reçois l’incontournable message « Save the date » pour les 30 ans de mon amie Romina, je réponds un grand OUI sans aucune hésitation. Ayant récemment déménagé à Stockholm, elle prévoit de fêter l’événement sur une péninsule proche de la ville et son anniversaire tombe le week-end du Midsommar [célébration du solstice d’été en Suède]. Une occasion à ne pas manquer !
Après ce petit moment d’euphorie, retour à la réalité : ça fait loin pour un week-end et j’évite de prendre l’avion pour mes escapades. Consciente de l’empreinte carbone que peut générer son invitation en Suède, Romina suggère aux invité·e·s de compenser leur trajet par des donations à la place des cadeaux d’anniversaire. Personnellement, ça me semblait un peu trop simple comme solution. Alors, j’étudie mes options depuis Strasbourg, en Alsace, où j’habite. Un voyage en train ? Pourquoi pas. Ou alors… y aller à vélo ? J’avais justement envie de sortir de ma zone de confort. L’idée avait germé.


Et quand y’a plus qu’à…
Quelques jours plus tard, je reçois un coup de fil de mon ami Lucas. Je lui fais part de mon projet et je lui propose de m’accompagner. Il n’a même pas besoin d’y réfléchir avant de me dire oui. Même si j’étais prête à partir seule, je suis soulagée à l’idée d’être à deux. Il s’agissait quand même de mon premier voyage à vélo.
On s’est rapidement mis d’accord sur les grandes lignes : départ de Trelleborg dans le sud de la Suède, puis cap sur les petits chemins à travers le pays jusqu’à Stockholm. Ça nous faisait un peu plus de 800 km avec environ 5 500m de dénivelé positif (oui, le pays n’est pas si plat que ça), soit une bonne dizaine de jours à vélo. Là-bas, le camping sauvage est autorisé, ce qui nous épargnait la recherche de logements. Il n’y avait plus qu’à poser nos congés et à réserver nos transports. Pour le reste, on s’est laissé porter !
Une insomnie et c’est parti !
Juin 2023 : c’est parti ! Au départ de Berlin on prend le train jusqu’à Rostock puis un ferry* de nuit jusqu’à Trelleborg, dans lequel j’ai tout de suite regretté de ne pas avoir pris de boules Quies. Notre journée à vélo démarre avec un peu de sommeil en retard, mais dans la bonne humeur. On roule le long du bord de mer puis à travers la campagne. À chaque coup de pédale, je m’éloigne un peu plus de mes préoccupations du quotidien. Seuls deux questionnements existentiels persistent : que va-t-on manger ? Et où qu’on va-t-on dormir ?
Pour notre fin d’étape, on choisit le premier lac sur notre tracé. Il nous attend après un peu plus de 90 km. Un high five et on saute dans l’eau, l’aventure commence bien !

Un duo de choc devient une petite meute
À travers des petits villages aux maisons rouges, des chemins bordés de lupins, des forêts à perte de vue et des lacs plus beaux les uns que les autres, on continue notre chemin. Assez rapidement je perds toute notion du temps. Après deux jours j’ai l’impression d’être partie depuis deux semaines. Le troisième jour, j’arrête de compter. Enfin presque.
Le quatrième jour, on accueille Lina, la copine de Lucas, à la gare d’Älmhult. Pour elle aussi, c’est le premier voyage à vélo et elle se prend rapidement au jeu : rouler, manger, rouler, nager, manger, dormir, repartir… Avec son maillot sur lequel est écrit « No sweat, no candy » [« Pas de sueur, pas de bonbons »], Lina instaure une nouvelle tradition : le passage au stand de bonbons dans tous les supermarchés. Après l’effort, le réconfort.
Réconfortante, mais aussi réjouissante, voilà comment je décrirais l’arrivée de notre dernier covoyageur : Josh, l’ancien colocataire de Lucas et un bon ami de Romina. À moins de 300 km de Stockholm, il nous rejoint pour la dernière ligne droite. Cet inconnu avec qui j’allais partager la tente pour les prochaines nuits a été un réel coup de cœur amical. Josh participait non seulement au bon équilibre au sein du groupe, mais il a aussi été à l’origine du hurlement instauré lors de nos passages dans les tunnels : « aouuuuwwww ! ». C’était la naissance d’une meute à vélo. Et la fin de toute prise au sérieux.
Fin heureuse et prometteuse
Arrivés à Stockholm puis sur les lieux de la fête, on était comblés. L’insomnie du début, les douleurs aux genoux – et celles aux fesses –, la journée de pluie, et les piqûres de moustique ont toutes été oubliées. Il nous restait simplement un profond sentiment de bonheur et de la gratitude pour ce qu’on venait de vivre ensemble. Ce n’était certes pas un grand exploit sportif, mais ça nous a montré que, même sans entraînement, on pouvait vivre des aventures mémorables avec les endorphines en prime.
Et j’y ai pris goût ! Depuis la Suède je suis partie sur la route des vins d’Alsace, j’ai longé le Danube pour retourner à ma ville d’Erasmus, Budapest, et plus récemment, je suis rentrée chez mes parents en Bavière depuis Strasbourg. Ce qui me plaît particulièrement lors de ces escapades, c’est de redécouvrir des chemins que je prenais avant en voiture ou en train. J’aime le fait que changer de mode de transport rend plus créatif dans la planification de voyages, mais aussi les rencontres qui se font sur le chemin et ce sentiment d’être hors du temps lorsque je suis en mouvement. J’ai envie de remercier Romina de m’avoir envoyé ce « Save the date » en janvier 2023 : tack så mycket Romina !
*Je suis consciente qu’il y a plus vert que le ferry, mais je n’ai pas entamé ce voyage dans l’optique de jouer l’écolo parfaite. Il faut bien commencer par des petits pas.
Note de POW France : Le ferry reste une meilleure alternative à l’avion pour plusieurs raisons, de son potentiel de décarbonation au fait qu’il est pris plus souvent sur de plus petites distances, comme ici dans l’aventure de Zoé. Si le sujet de l’impact du ferry vous intéresse et que vous voulez savoir comment calculer son impact, un article ici